Le macrozoobenthos du Bois de Cise
Inventaire du macrozoobenthos sur le platier rocheux intertidal du Bois de Cise (Somme, France) en 1981, 1983 et 2017
L'équipe

De gauche à droite : Enzo Boutin, Michèle Lefranc, Claudine Ducrotoy, Jean-Paul Ducrotoy, Gérard Griffon, Geoffroy Mahieux et Denis Lefranc qui a pris la photo.
Protocole
Le platier rocheux ou plate-forme littorale, ou encore plate-forme d'érosion (ou d'abrasion) du Bois de Cise (Somme, France), est relativement plan, taillé par les vagues et la météorisation subaérienne dans la craie, roche présentant un minimum de résistance à la désagrégation. Des promontoires rocheux et des blocs de craie arrachés à la falaise lui donnent un aspect chaotique alors que des nappes de sédiment sableux s’étendent entre les reliefs les plus marqués. Il s'élève lentement jusqu'au pied de la falaise de craie où s’accumule un cordon de galets de silex à la pente bien marquée.
Trois radiales ont été échantillonnées sur le substrat rocheux (y compris dans les cuvettes) et dans les nappes de sable en 1981, 1983 et 2017.
· Une radiale perpendiculaire au pied de la falaise prend son origine au pied des escaliers d'accès à la mer : radiale B
· Parallèlement, à 100 m, une radiale se situe au nord de la radiale B : radiale A
· Une autre radiale parallèle, distante de 100m, se trouve au sud : radiale C

Des prélèvements sont réalisés sur chacune des radiales tous les 20 m vers le bas de l'eau, à l'exception des points situés sur les galets. 4 quadrats de 1/4 m2 sont placés systématiquement en ligne perpendiculaire à la radiale et séparés d'environ 2,5 m (détails dans DUCROTOY & SIMON, 1984).
Les algues sont identifiées et leur couverture estimée en %.
Les invertébrés sont dénombrés sur place. En cas de doute sur leur détermination, des échantillons sont emmenés au laboratoire et identifiés.
Le même protocole a été appliqué en mai 1981 lors de stage de professeurs de l'enseignement secondaire à la Station d'études en baie de Somme, en mai 1983 par Ducrotoy et Simon pour évaluer l'impact d'un envasement de l'estran et en mai-juin 2017 dans la perspective du suivi d'un rétablissement éventuel des communautés végétales et animales depuis cette dernière perturbation.
Liste des espèces relevées en 1981
SPONGIAIRES
Halichondria panicea
Hymeniacidon sanguinea
CNIDAIRES
Sertularella polysoniae
Sertularia compressa
Hydralmenia falcata
Plumularia setacea
Obelia geniculata
Campanularia verticillata
Hydrozoaire incerta sedis
Nemertsia antenina
Abietinaria abietina
Tealia felina
Sagartia troglodites
Actinia equina
Actinia fragacea
BRYOZOAIRES
Flustra foliacea
Membranipora membranicea
Alcyonidium gelatinosum
ANNELIDES
Lepidonotus squamatus
Lagisca extenuata
Harmothoe sp.
Eulalia veridis
Nephtys humbergii
Perinereis sp.
Polydora ciliata
Lanice conchilega
Pomatoceros triqueter
MOLLUSQUES
Lepidochitona cireneus
Acanthochitona crinitus
Patella vulgata
Gibbula cineraria
Gibbula umbilicalis
Littorina littorea
Littorina saxatilis complex
Crepidula fornicata
Nucella lapilus
Archidoris pseudoargus
Cadlina laevis
Mytilus edulis
Barnea candida
Tapes pullastra
PYCNOGONIDES
Pycnogonum littorale
Phoxichilidium tubulariae
CRUSTACES
Balanus balanoides
Balanus crenatus
Elminius modestus
Chtalamus stellatus
Sphaeroma serratum
Idothoe baltica
Caprella sp.
Hyale nilsoni
incerta sedis
Pisidia longicornis
Porcellana plathycheles
Macropipus puber
Macropipus pusillus
Carcinus maenas
Cancer pagurus
Pilumnus hirtellus
ECHINODERMES
Ophiotrix fragilis
Amphipholis squamata
Asterias rubens
TUNICIERS
Ascidia sp.
L'envasement de 1983
L’étude de l’évolution spatio-temporelle de la biocénose macrozoobenthique de substrat dur, décrite en 1981, a permis de préciser les mécanismes d’action d’une perturbation liée à des aspects sédimentaires. En effet, en 1982, une crème de vase a recouvert les estrans d’une couche de plusieurs millimètres ayant causé un envasement des faciès rocheux. Ces sédiments fins provenaient probablement des travaux de terrassement de la falaise du Pays de Caux lors de la construction de centrales nucléaires, et peut-être aussi, de dragages réalisés lors de l’aménagement du port du Tréport.
Il s’agit d’observations menées en 1983 par DUCROTOY & SIMON (1984).
DUCROTOY J.-P., SIMON S. 1984
Evolution spatio-temporelle d'une biocénose macro-benthique de substrat dur après envasement.
Picardie Ecologie, 2 (1) : 77-86.
L’impact du colmatage par les sédiments fins s’exerce suivant un gradient depuis le bas vers le haut de l’estran rocheux, laissant inaffecté approximativement le 1/3 supérieur du platier.
· 19 espèces présentes en 1981 sont absentes en 1983 dont sept espèces de Mollusques, en particulier le bivalve suspensivore perforant Barnea candida.
· Vers le haut d’estran, peu affecté par le colmatage, on assiste à un accroissement de la richesse spécifique avec l’installation de six espèces présentes en 1981, telles que le décapode Porcellana plathycheles ou l’ophiure Amphipholis squamata.
· Sur la moitié inférieure de l’estran, le ver Polydora ciliata, tolérant à l’envasement, colonise le nouveau substrat à grande échelle avec la même efficacité qu’il colonise la surface des rochers de craie couverts de vase.
· Des espèces pionnières des sédiments meubles, comme l’échinoderme Psammechinus miliaris, s’installent.
· L’ascidie Ascidia sp. pullule.
Comme le mentionne SALEN-PICARD (1983), un déséquilibre dû à l’envasement, non lié à d’autres perturbations (pollution chimique par exemple), peut provoquer une évolution de la biocénose. Lors de l’installation de nouvelles espèces pionnières, le maintien d’espèces tolérantes et aussi de quelques espèces exclusives peut aboutir, localement, à une augmentation de la diversité biologique.
Liste des espèces relevées en 2017
SPONGIAIRES
Halichondria panicea
Perlevis (Hymeniacidon) sanguinea
CNIDAIRES
Campanularia verticillata
Nemertsia antennina
Urticina (Tealia) felina
Sagartia troglodytes
Actinia equina
Actinia fragacea
Anemonia viridis
Actinothoe sphyrodeta
BRYOZOAIRES (en épave)
Flustra foliacea
Membranipora membranacea
Alcyonidium gelatinosum
ANNELIDES
Eulalia viridis
Perinereis sp.
Polydora ciliata
Lanice conchilega
Pomatoceros triqueter
Arenicola marina
Heteromastus fifliformis
sipunculien
MOLLUSQUES
Lepidochitona cireneus
Acanthochitona crinitus
Patella vulgata
Gibbula cineraria= Phorcus cineraria
Gibbula umbilicalis
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Crepidula fornicata
Nucella lapilus
Mytilus edulis
Tapes pullastra
Ostrea edulis
Littorina obtusata
CRUSTACES
Balanus balanoides
Balanus crenatus
Elminius modestus= Austrominius modestus
Chtalamus stellatus
Sphaeroma serratum
Idothea baltica
Porcellana plathycheles
Macropipus puber
Macropipus pusillus
Carcinus maenas
Cancer pagurus
Pilumnus hirtellus
Liocarcinus depurator
Pachygraptus marmoratus
Crangon vulgaris
Bathyporeia sp
UROCHORDES
Molgula sp
Evolution spatio-temporelle
Répartition d'espèces sélectionnées le long des radiales A, B et C en 2017
Abcisses : densités au m2
Ordonnées : ditances en m depuis le haut de la radiale
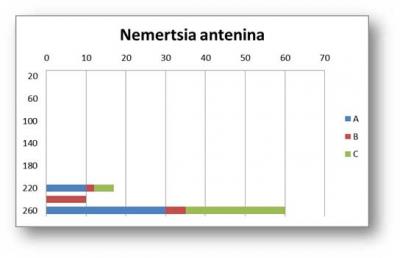
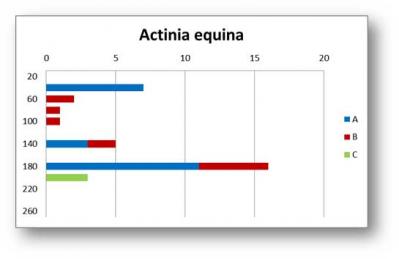
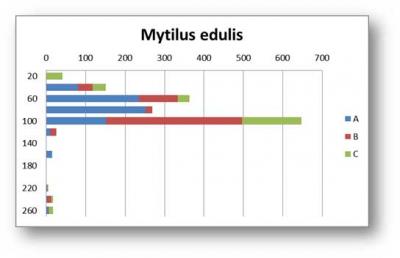
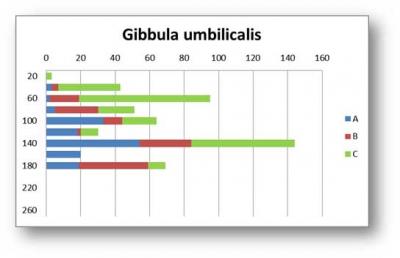
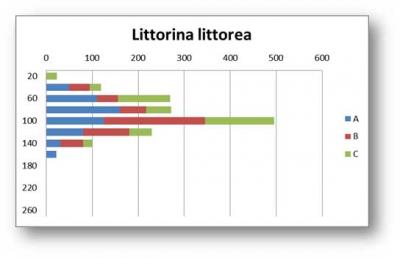
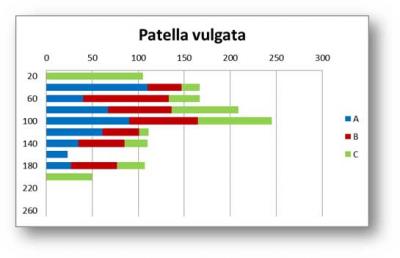
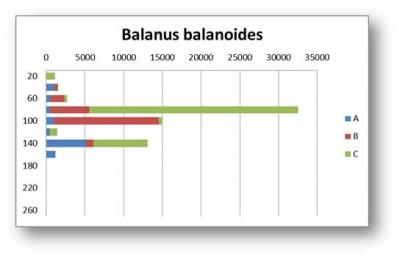
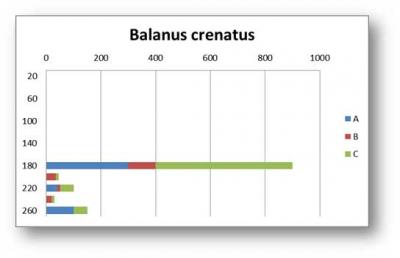
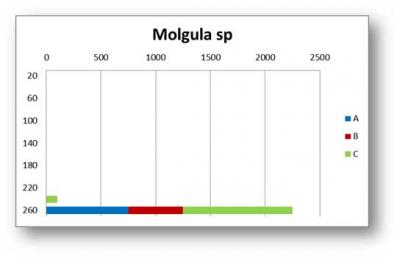
Comparaison de la situation en 2017 avec 1983
On constate, qu’en 2017, on revient à un éventail d’espèces typiques des estrans rocheux et des sables légèrement envasés. La recolonisation s’est déroulé bien avant cette date mais une biocénose moins stressée s’est maintenue jusqu’alors.
Comparaison entre 1981 et 2017
Le relevé de 2017 comporte un certain nombre d'incertitudes, notamment quant à l’identification de quelques espèces, notamment les balanes. Cependant, on peut penser que la richesse spécifique est proche de celle de 1981, avant le colmatage par les particules fines en provenance des travaux de terrassement réalisés sur la côte du pays de Caux.
On note des espèces nouvellement échantillonnées, alors que certaines ne sont plus retrouvées sur les radiales.
· On ne remarque pas d'évolution pour les SPONGIAIRES qui se maintiennent sur le substrat rocheux du bas d’estran.
· 7 espèces de CNIDAIRES disparaissent de nos relevés :
o Sagartia troglodites
Abietinaria abietina
Sertularella polysoniae
Sertularia compressa
Hydralmenia falcata
Plumularia setacea
Obelia geniculata
o 2 nouvelles espèces sont échantillonnées :
Anemonia viridis
Actinothoe sphyrodeta
· Sagartia troglodytes se maintient dans les niveaux les plus bas
· Les BRYOZOAIRES sont retrouvés en épave, comme en 1981.
· Chez les ANNELIDES, 4 espèces ne sont pas retrouvées :
o Nephtys humbergii
Lepidonotus squamatus
Lagisca extenuata
Harmothoe sp.
Cela peut être du à la méthode d’échantillonnage inadaptée à un bon tamisage des sédiments.
o 3 nouvelles espèces sont échantillonnées :
Arenicola marina
Heteromastus fifliformis
1 sipunculien
· Tous les MOLLUSQUES sont retrouvés à l'exception de Barnea candida
o 2 nouvelles espèces apparaissent :
Ostrea edulis
Littorina obtusata
· 3 espèces de CRUSTACES disparaissent :
Caprella sp.
Hyale nilsonni
Pisidia longicornis
o 4 espèces s'installent :
Liocarcinus depurator
Pachygraptus marmoratus
Crangon vulgaris
Bathyporeia sp
· Les PYCNOGONIDES, les ECHINODERMES sont absents en 2017
· On note le développement spectaculaire du TUNICIER Molgula sp. Qui dépasse 1000 individus au m2 dans l’infratidal, donc visible uniquement lors des très grandes marées.
- L’ascidie Ascidia sp. est remplacée par cette espèce qui prend avantage de l’apport de sédiments.
Conclusions
L’évolution faunistique observée pourrait correspondre à trois phénomènes écologiques synchrones :
- Certaines espèces comme Barnea candida, victimes de l’envasement de 1982-1983, n’ont pas réussi à recoloniser le platier du Bois de Cise. Il est possible que la prochaine méta-population voisine se soit située trop loin.
- Le couvert algal a diminué de façon drastique ne permettant plus aux espèces animales qui les occupent de survivre en quantité suffisante pour être échantillonnées par la méthode choisie. Il s’agirait de cnidaires, de petits crustacés et de pycnogonides plutôt fragiles.
- Un ensablement (probablement des sablons comme en baie de Somme) se produit sur au moins les 2/3 du platier, vers le bas, mais surtout dans les niveaux moyens. Cela pourrait expliquer la disparition de certains polychètes peuplant des milieux propres et, a contrario, l’occupation des grandes étendues de sédiment par des espèces des sédiments meubles, particulièrement envasés comme ceux recherchés par H. filiformis. La même remarque peut s’appliquer aux crustacés, sachant que les deux petits crabes occupent des fonds de cuvette quelque peu envasés. Le relai entre les deux espèces de tuniciers est aussi révélateur du recouvrement sédimentaire sur les deux tiers inférieurs du platier.
 Le sable recouvre de grandes étendues du platier sur la radiale B
Le sable recouvre de grandes étendues du platier sur la radiale B
 Le platier est raboté sur la radiale C
Le platier est raboté sur la radiale C
On peut expliquer cette évolution en remarquant que l’hydrodynamisme local s’est renforcé, les courants de marée ayant probablement gagné en compétence, conséquence probable de l’accélération de l’élévation du niveau de la mer en liaison avec le réchauffement planétaire.
Les indices en sont :
- Le déclin du couvert algal et la diminution spectaculaire des bancs de moules Mytilus edulis.
- Les sédiments poussés par la marée, comme en baie de Somme.
- La taille impressionnante des galets du haut d’estran, le mouvement intense de ceux-ci ayant probablement joué un rôle dans la force physique du phénomène d’érosion du platier.
- Le recul accéléré de la falaise et la mise en suspension de poussière de craie.
A ces facteurs physiques, il faut ajouter le piétinement par les touristes dont la fréquentation augmente d’année en année. La pêche à pied, qui se pratique toujours, semble, par contre, passée de mode. Il est regrettable que les radiales ait été positionnées dans l’axe même de l’escalier d’accès depuis le parking.
Date de dernière mise à jour : 04/03/2018